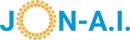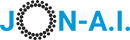L'impact environnemental de l'IA
L'intelligence artificielle est une arme à double tranchant pour notre planète. D'une part, il s'agit d'une technologie extrêmement prometteuse, qui offre de nouveaux outils puissants pour résoudre nos crises environnementales les plus pressantes. D'autre part, l'infrastructure même qui alimente l'IA crée un fardeau environnemental colossal, consommant de l'énergie et des ressources naturelles à un rythme effarant et toujours croissant. Comprendre cette dualité, à savoir l' « empreinte » négative de l'IA et son « empreinte » positive, est l'un des défis les plus critiques de notre époque.
Partie 1 : L'empreinte : le coût environnemental de l'IA
Le coût environnemental le plus visible de l'IA est son incroyable besoin croissant d'électricité. Cette demande provient des dizaines de milliers de serveurs puissants hébergés dans de vastes centres de données, nécessaires à la formation et à l'exécution de modèles d'IA. Notre mix énergétique mondial étant toujours fortement tributaire des combustibles fossiles, cette consommation d'électricité entraîne directement d'importantes émissions de gaz à effet de serre.
Une perte d'énergie sans précédent
L'ampleur de cette consommation d'énergie est presque difficile à comprendre. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit que la demande d'électricité spécifiquement pour l'IA sera multipliée par dix entre 2023 et 2026. Les centres de données du monde entier contribuent déjà entre 2,5 % et 3,7 % aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit une part supérieure à celle de l'ensemble du secteur de l'aviation. Cette demande massive met à rude épreuve les réseaux électriques et, paradoxalement, oblige les entreprises de services publics à retarder la mise hors service des centrales à combustibles fossiles afin de garantir une alimentation électrique fiable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les opérations d'IA.
Le coût caché de l'eau
Au-delà de l'énergie, l'IA a une soif vorace d'eau douce. Cette eau est essentielle au refroidissement des centres de données qui génèrent d'énormes quantités de chaleur résiduelle. Il s'agit d'une utilisation « consommatrice », car l'eau est évaporée et perdue dans le bassin versant local. On estime que l'entraînement d'un seul modèle tel que le GPT-3 a consommé 700 000 litres d'eau douce, tandis qu'une simple conversation de 20 à 50 questions avec ChatGPT peut utiliser une bouteille d'eau de 500 ml. Cela met à rude épreuve l'approvisionnement en eau local, d'autant plus que de nombreux centres de données sont construits dans des régions où l'eau est rare.
Du silicium à la décharge
L'impact environnemental n'est pas uniquement opérationnel. Un coût « intrinsèque » important provient du matériel lui-même. La fabrication de puces d'intelligence artificielle à hautes performances est un processus gourmand en énergie et en ressources. Plus important encore, le rythme rapide de l'innovation en matière d'intelligence artificielle accélère le cycle de remplacement du matériel, ce qui contribue à une crise croissante des déchets électroniques dangereux (déchets électroniques). En 2022, moins d'un quart des 62 millions de tonnes de déchets électroniques produits dans le monde ont été correctement recyclés.
Impact comparatif des activités numériques
Une seule requête adressée à un modèle d'IA générative est nettement plus gourmande en ressources qu'une recherche sur le Web traditionnelle.
| Activité | Émissions de carbone estimées (gCO2e par unité) |
|---|---|
| Recherche Google standard | 0,2 |
| Requête ChatGPT-4 (texte) | 4,32 |
| Génération d'images par IA (par exemple, Midjourney) | 1.9 (pour le GPU Nvidia A100) |
| Vidéo en streaming (1 heure, HD) | 34 |
Partie 2 : L'empreinte de main - L'IA comme outil de développement durable
Bien que son empreinte soit impressionnante, l' « empreinte » de l'IA, c'est-à-dire sa capacité à avoir un impact environnemental positif, est tout aussi profonde. La capacité unique de l'IA à analyser des ensembles de données massifs et complexes et à optimiser les systèmes est appliquée pour résoudre certains de nos plus grands défis environnementaux.
- Améliorer la science du climat : L'IA révolutionne la modélisation du climat en permettant de prévoir avec plus de précision les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les ouragans et les inondations, ce qui contribue à améliorer la préparation aux catastrophes et à sauver des vies.
- Optimisation des systèmes mondiaux : l'IA rend les systèmes critiques plus efficaces. Il contribue à créer des réseaux énergétiques intelligents capables de mieux intégrer les énergies renouvelables, et il permet une « agriculture de précision » qui utilise moins d'eau et d'engrais en les appliquant uniquement là où cela est nécessaire.
- Accélérer l'innovation verte : En laboratoire, l'IA accélère considérablement la découverte de nouveaux matériaux essentiels aux technologies vertes, tels que ceux nécessaires pour des batteries plus efficaces ou pour capturer le carbone directement dans l'atmosphère.
- Stimuler l'économie circulaire : les robots alimentés par l'IA peuvent trier les déchets à recycler avec une rapidité et une précision surhumaines, et l'IA peut optimiser les chaînes d'approvisionnement afin de réduire la surproduction et le gaspillage.
- Protection de la biodiversité : les scientifiques de la conservation utilisent l'IA pour traiter des millions d'images de pièges photographiques en quelques semaines au lieu de plusieurs années, et les applications de science citoyenne comme iNaturalist utilisent l'IA pour identifier les espèces, créant ainsi une énorme base de données mondiale pour la recherche.
Aperçu du concept : le paradoxe de l'efficacité
L'un des principaux défis liés à l'utilisation de l'IA pour la durabilité est un concept économique connu sous le nom de paradoxe de Jevons, ou « effet rebond ». Cette théorie met en garde contre le fait que lorsque la technologie rend l'utilisation d'une ressource plus efficace (et donc moins coûteuse), nous finissons souvent par en consommer une plus grande partie dans l'ensemble.
Par exemple, si l'IA rend les voyages en avion plus économes en carburant et moins chers, un plus grand nombre de personnes pourraient décider de prendre l'avion, ce qui pourrait anéantir les économies par vol avec une augmentation considérable du nombre total de vols. Cela signifie que le simple fait de rendre les choses plus efficaces grâce à l'IA n'est pas une garantie de durabilité. Ces gains d'efficacité doivent être associés à des politiques ou à des modèles commerciaux qui gèrent la consommation globale afin de garantir que l' « empreinte » de l'IA l'emporte réellement sur son « empreinte ».
Contrôle rapide
Quel énoncé décrit le mieux la « dualité » de l'impact environnemental de l'IA ?

Récapitulatif : L'impact environnemental de l'IA
Ce que nous avons abordé :
- L'IA a une « empreinte » négative significative en raison de l'immense consommation d'énergie et d'eau des centres de données et des déchets électroniques liés à l'obsolescence rapide du matériel.
- Une requête basée sur l'IA consomme beaucoup plus d'énergie qu'une recherche Google traditionnelle.
- L'IA possède également une puissante « empreinte » positive, qui contribue à améliorer les modèles climatiques, à optimiser les réseaux énergétiques, à accélérer l'innovation verte et à protéger la biodiversité.
- L' « effet rebond » est un défi majeur, car les gains d'efficacité liés à l'IA peuvent entraîner une augmentation de la consommation globale.
Pourquoi c'est important :
- L'impact environnemental net de l'IA n'est pas encore déterminé. Cela dépend des choix que nous faisons aujourd'hui (prioriser l'efficacité, investir dans des infrastructures vertes et exiger de la transparence de la part des entreprises technologiques) pour faire en sorte que l'IA devienne une force au service de la durabilité.
Prochaine étape :
- Nous aborderons l'une des questions éthiques les plus discutées : l'IA va-t-elle me prendre mon travail ?